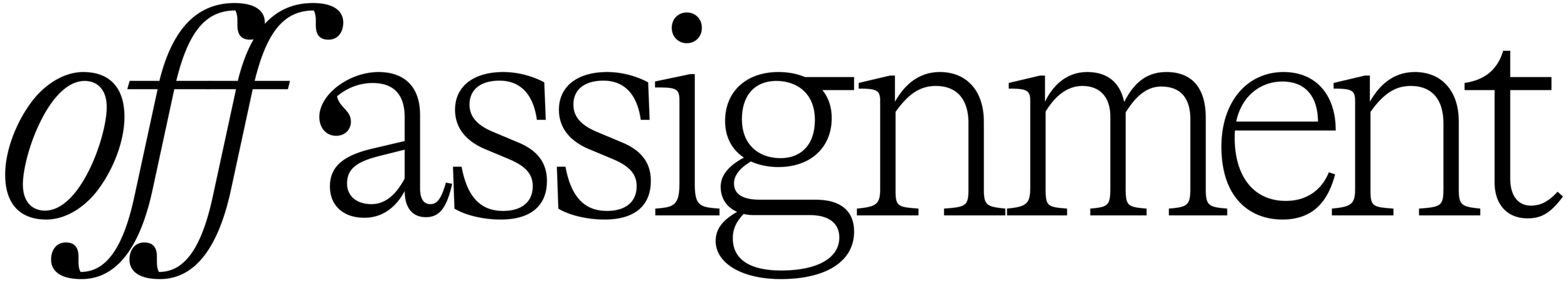Au sosie de Samuel Beckett

Je vous ai aperçu en attendant de descendre de l’avion qui venait de se poser à l’aéroport de Prague. C’est ma copine qui a attiré mon attention sur vous : un homme d’une cinquantaine d’années assis une ou deux rangées derrière nous, de l’autre côté du couloir central. Je me souviens d’être resté un long moment bouche bée, dans une sorte de sidération béate et ravie devant le sosie parfait, mais vraiment parfait, de l’écrivain Samuel Beckett.
On était en octobre 2007. Pour la première fois depuis que j’avais quitté la France trois ans auparavant – sans me douter que mon départ allait être définitif –, je revenais en Europe rendre visite à une amie tchèque connue à Paris. Si je me réjouissais de retrouver une amie de mes débuts d’écrivain, je n’en étais pas moins conscient de tous les changements survenus dans l’intervalle de mon départ. Un de mes textes avait été publié en grande pompe dans la reine des revues littéraires, The New Yorker, et fort de ce succès, je m’efforçais de boucler ce que j’espérais être mon premier roman, une grande fresque historique se déroulant à Paris sur fond d’occupation nazie. (J’avais relégué dans un tiroir le manuscrit d’un roman écrit précédemment en français.) Il y avait aussi avec moi ma copine Bosie qui ne parlait pas français, ce qui allait nous obliger à utiliser l’anglais dans nos conversations à trois avec mon amie tchèque. La perspective de ce basculement linguistique m’avait-elle mis la puce à l’oreille ? Est-ce que je sentais, déjà, un tournant dans mon existence, un pan de ma vie qui s’achevait comme une porte se refermant derrière moi ? Quelque part, je croyais toujours que, tôt ou tard, j’allais retourner vivre en France et renouer avec ma vie d’avant, mon cercle d’amis, ma thèse laissée en plan (qui portait sur les écrivains bilingues, dont Beckett) ainsi que les ateliers d’écriture où j’avais commis mes premiers textes littéraires.
Si le fil rouge de mon récit – autant dire de ma vie – est la langue française, celui de mon apprentissage de cette langue n’est nul autre que Samuel Beckett. Il fut un temps où je passais des heures à étudier et à éplucher des photos de cet écrivain génial et bilinguissime. Car en l’absence d’entretiens et d’interviews, on a l’embarras du choix des photos et autres clichés pris par des amis ou des paparazzis, par des artistes célèbres et moins célèbres. Peut-être, dans la contemplation des instantanés de sa vie d’écrivain immortalisés par l’appareil, espérais-je découvrir un élément inédit, un indice essentiel dans le cadre de mon parcours d’apprenant du français. Aujourd’hui encore, il me suffit de fermer les yeux pour faire défiler une panoplie d’images qui me sont aussi familières que celles de mon enfance : Beckett dans sa maison de campagne d’Ussy devant sa table de travail où sont mis en évidence les volumes de son Littré ; Beckett au musée contemplant un tableau de Bram van Velde ; Beckett lors d’un repas en famille chez son ami Avigdor Arikha ; Beckett assis sur la margelle d’une fontaine avec son éditeur new-yorkais Barney Rosset ; Beckett au jardin du Luxembourg habillé d’un manteau trop grand pour lui ; Beckett à la plage en compagnie de ses amis, torse nu et en short, chaussé de bottines en cuir ; Beckett rayonnant dans sa toge de docteur honoris causa ; Beckett attablé à la terrasse de la Closerie des Lilas ; Beckett en pardessus à doublure écossaise, rue Saint-Jacques, sous la grisaille parisienne…
Qui mieux que moi était à même de reconnaître le regard perçant et le profil d’aigle tant photographiés du célèbre écrivain irlandais avec son abondante chevelure zébrée d’une mèche blanche comme un trait de pinceau sur une toile sombre (motif qui ira s’inversant au fur et à mesure de sa vie) ? Je mets au défi quiconque de décrire avec davantage de précision et d’amour le soupçon de rétrognathisme qui fait se bomber légèrement la fossette de la lèvre supérieure sur les photos où l’intéressé se fend d’un de ses rarissimes sourires. Tout cela pour dire que j’étais mieux placé qu’un autre pour savoir si je me trouvais en présence d’un véritable sosie de Beckett et non d’une pâle copie.
Il me souvient que vous portiez des lunettes à monture d’acier et une chemise Oxford blanche dont vous aviez même – détail qui m’a enchanté – retroussé les manches à l’instar de votre homologue, qui ne portait jamais (ou presque jamais) de chemises à manches courtes. Avec vos cheveux grisonnants et légèrement ondulés – je pense au très beau portrait qui figure sur la couverture de mon édition de poche de Molloy –, vous étiez le portrait craché du Beckett du milieu des années 1950, époque où il écrivait sa trilogie romanesque et les pièces de théâtre qui ont fait sa réputation et sa renommée. Mais au-delà de la simple ressemblance physique et vestimentaire, j’ai cru reconnaître dans votre posture, dans votre manière de vous tenir et jusque dans votre port de tête, celui qui a déclaré préférer « la France en guerre à l’Irlande en paix ».
C’est la réponse qu’il aurait donnée pour expliquer sa décision, pendant la guerre, de s’engager dans la Résistance en dépit de son statut de ressortissant de pays neutre. On ne peut qu’applaudir son courage de rester dans un pays en guerre où il a fait preuve d’un héroïsme incontestable, risquant sa peau aux côtés de ses amis français ; mais j’y vois surtout une volonté de rester dans la langue française, de ne pas revenir sur ses pas, sur sa décision de quitter sa terre natale – à croire que c’était pour lui une question de vie ou de mort. Il savait ce qu’il faisait en choisissant « la France en guerre ». Dans la même optique, dix ans auparavant, il avait démissionné d’un poste prestigieux et tourné le dos à une carrière toute faite de professeur de littérature à l’université de Dublin.
“Malgré les années, j’ai toujours l’impression de me retrouver dans cet avion à repousser l’inévitable pendant ces quelques minutes d’immobilité et d’attente sur le tarmac.”
Loin de moi de vouloir comparer ma vie à la sienne mais je ne peux m’empêcher de penser à une autre France « en guerre », une guerre, disons, infiniment moins dangereuse que celle qu’a connue Beckett et que j’ai fuie comme un lâche en me disant que je m’envolais vers de meilleurs horizons. Il ne se passe pas un jour sans que je remette en question ma décision de partir, mais pour autant je n’en oublie pas les désagréments, le racisme ordinaire, les agressions évitées de justesse et les prises de bec avec des cailleras qui voyaient en moi une cible idéale, une proie facile. J’étais souvent tendu, sur mes gardes, quand je marchais dans la rue ou que je rentrais chez moi, seul, en RER. Il y avait des stations de métro où j’évitais de descendre pour ne pas croiser, à la sortie, les petites frappes qui en avaient fait leur repaire, leur lieu de commerce privilégié. Puis je me souviens du jour où, en revenant d’un ciné avec une amie, nous sommes tombés sur des émeutiers en plein affrontement avec les forces de l’ordre dans une bifurcation de couloir à Châtelet-Les Halles. La tension était à son comble, les deux camps figés dans des postures de chiens de faïence. Quand, bien des années plus tard, j’ai regardé Paris est à nous et son plan-séquence tourné dans les rues de Paris lors des manifestations liées aux évènements de Charlie Hebdo, il m’a semblé revoir les CRS que j’avais croisés, ce jour-là, au détour d’un couloir de métro.
Y aurait-il en moi un obscur désir de me rattraper, de me racheter, face à ma lâcheté d’autrefois, dans mon « exil » au fin fond de la Californie où le hasard a voulu que j’échoue ? C’est peut-être pourquoi je ne ménage aucun effort pour vivre mon quotidien en français : lectures, films, radio, écriture, tout se passe quasi exclusivement dans cette langue que pourtant je ne parle avec personne. Cela a pour résultat (nul ne s’en étonnera) de me condamner à une solitude certaine mais aussi, parfois, exaltante et vertigineuse, une solitude que j’assume et même que je recherche.
Avec plus de quatorze ans de recul, je me demande si j’aurais dû interpréter votre présence dans l’avion comme un signe, un message d’outre-tombe. Un rappel à l’ordre, en quelque sorte. Je ne l’ai pas écouté, celui qui avait été jadis mon étoile polaire, mon Virgile ; je n’ai pas suivi son exemple. Il avait donc jugé bon d’envoyer comme émissaire son sosie le plus ressemblant pour me faire comprendre mon erreur : je m’étais laissé éloigner de mon chemin, je n’étais plus sur la bonne voie. Malgré les années, j’ai toujours l’impression de me retrouver dans cet avion à repousser l’inévitable pendant ces quelques minutes d’immobilité et d’attente sur le tarmac. Comme le constate, la veille de son suicide, le héros du Feu follet de Pierre Drieu la Rochelle : « J’aurais voulu captiver les gens, les retenir, les attacher. Que rien ne bouge plus autour de moi. Mais tout a toujours foutu le camp. » Or, sans m’en rendre compte, j’avais fait mon choix, celui de ne pas retourner en France, de me mettre à écrire en anglais, de rater mon exil.
Je peux compter sur les doigts d’une main les amis qu’il me reste à Paris, en France, en Europe, et qui seraient heureux d’assister au retour du pote prodigue, tout en sachant qu’avec mon visa touristique les retrouvailles seraient de courte durée, avec obligation de quitter le territoire une fois le temps de séjour écoulé. Un vrai retour, un retour digne de ce nom et selon les règles de l’art, me paraît aussi compliqué qu’un voyage dans le temps.
À un moment, évidemment, j’ai pensé à vous aborder, à vous interpeller… mais pour quoi faire, quoi dire, et dans quelle langue ? Aurais-je dû me prendre en photo avec vous comme un vulgaire touriste ? Je me disais que vous aviez déjà été importuné de la sorte, et ce plus d’une fois, par des badauds qui n’en revenaient pas de votre ressemblance avec l’écrivain irlandais d’expression française. Et puis, étant d’un naturel réservé – c’est mon éducation coréenne, c’est plus fort que moi –, je pars du principe qu’en général les gens aiment qu’on les laisse tranquilles. Cela aurait servi à quoi de me planter devant vous pour bafouiller quelques mots banals et sans intérêt ? Non, il valait mieux garder mes distances et rester dans mon rôle d’observateur, comme je l’avais fait, dans le temps, avec les images à l’effigie du maître.
Six ans plus tard, au cours d’une résidence d’écrivain, j’abandonnerai mon grand roman historique sur l’occupation de Paris. « Le mieux serait peut-être de laisser tomber », m’a dit une professeur de creative writing que j’étais allé voir dans son bureau et à qui j’avais fait part de mes difficultés d’écriture. Avais-je un peu trop insisté sur mes pannes de motivation ? Avait-elle lu dans mes pensées ? Car j’allais passer les années suivantes à tout faire sauf écrire, me dispersant dans des activités plus éloignées les unes que les autres de la littérature. Reconverti dans la revente de jouets anciens, qui était devenue mon occupation principale, je m’approvisionnais sur des sites d’enchères en ligne et lors de voyages éclairs au Japon où je sillonnais brocantes et magasins dans les dédales de Tokyo et d’Osaka. Ce passage à vide dura deux ans. Puis, au printemps 2016, alors que les nouvelles des attentats du 13 novembre continuaient de tourner en boucle dans ma tête, je me suis enfin remis à l’écriture en choisissant pour thème le Paris que j’avais connu, celui que j’avais quitté, ou plutôt fui, dans ma jeunesse. Je reprenais la plume pour pleurer la ville qui m’avait vu naître en tant qu’écrivain. Au lieu d’écrire sur la grande guerre comme dans mon roman abandonné, j’allais raconter celle que j’avais vécue, celle de ma vie d’étranger à Paris.
J’étais en France au moment des attentats du 11 septembre et maintenant, lors des attentats de Paris, je me trouvais aux États-Unis ; toujours est-il que les deux évènements m’ont touché d’une manière différente. Bien qu’à l’époque j’aie été secoué et affolé par la tragédie qui se déroulait à New York, elle ne m’a pas ébranlé jusqu’au fond de mon âme comme les évènements du 13 novembre. Il n’y a que quand je regarde un film sur l’occupation japonaise de la Corée – ma mère est née vers la fin de cette période et mon oncle a fait toute sa scolarité à l’école japonaise – qu’il m’arrive de ressentir la même émotion, la même indignation, mais aussi la même ambivalence.
On venait de déverrouiller les portes et les passagers de première classe commençaient déjà à quitter l’avion. Autour de moi, ça s’étirait les bras et ça levait les yeux de son portable. J’entendais le cliquetis désordonné des coffres à bagages qu’on ouvrait et qu’on refermait. Les hôtesses se tenaient immobiles à l’autre extrémité de la cabine, qui se vidait petit à petit. Et vous voilà dans votre rangée près du hublot à attendre que vos voisines finissent de ranger leurs affaires.
Depuis mon siège, je continuais à vous scruter en toute impunité. (Quelle foutaise que celle qui prétend qu’on peut « sentir » un regard porté sur soi par un autre !) Vous aviez l’air soucieux, abîmé dans vos réflexions, ou peut-être que vous ne faisiez que prendre votre mal en patience comme les autres. Étrangement, je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite, aucune image de vous après la descente de l’avion, comme si vous n’aviez existé que dans cet interstice temporel entre l’atterrissage et l’ouverture des portes. (De même qu’à Paris, en montant dans l’avion, je ne vous avais pas remarqué installé dans votre siège.) Aujourd’hui, quand j’essaie de vous imaginer à l’aéroport de Prague, ce qui me revient c’est Beckett fendant la foule de sa démarche que je ne connais que par photos interposées, même si, avec le temps, elle m’est devenue si familière que je ne saurais dire, finalement, quelle en est la part de vérité et la part d’illusion.
À PROPOS DE L’AUTEUR
David Hoon Kim a fait ses premières armes littéraires en fréquentant les ateliers d'écriture du Crous et de la Sorbonne, avant de poursuivre son éducation aux États-Unis, à l'université d'Iowa et à Stanford. Ses nouvelles ont été publiées dans diverses revues québécoises, françaises et américaines, dont XYZ La revue de la nouvelle, Nouveau Projet, Rue Saint Ambroise, Brèves et The New Yorker. Il est également l'auteur d'un livre en anglais, Paris Is a Party, Paris Is a Ghost. Des extraits de ses textes en français sont disponibles sur son site davidhoonkim.com
Où vous trouvez-vous actuellement ?
Je suis dans la salle à manger, assis à une grande table en acacia massif où j’écris ces lignes. Cela fait deux ans que j’en ai fait mon espace de travail, même si je dispose d’une petite pièce à part aménagée en bureau. En 2019, suite à une fuite d’eau qui a causé pas mal de dégâts dans la maison, j’ai dû transformer mon bureau en garde-meubles pendant les quelques mois qu’ont duré les travaux de réparation. J’ai alors commencé à travailler dans la salle à manger et l’habitude m’est restée. Deux des murs de la pièce sont entièrement composés de fenêtres qui donnent sur la cour arrière de la maison où trône un vieil érable recouvert de plantes grimpantes et dont les branches, faute d’entretien, frôlent le gazon en friche. J’entends parfois le croassement des corbeaux du quartier, le sempiternel roucoulement des tourterelles dites « tristes », et de temps à autre le grondement lointain d’un train, mais aussi, hélas, les coups de marteau de mon voisin bricoleur et amateur de baseball qui aime s’entraîner chez lui à toute heure de la journée, si bien que j’entends, de ma table, le bruit persistant et agaçant d’une balle frappant ce que j’imagine être un filet installé sur la pelouse, de l’autre côté de la haie qui divise nos maisons.
Si vous deviez choisir un endroit préféré dans Paris, ce serait lequel et pourquoi ?
Il y a l’Art Brut près du centre Beaubourg, un petit café où mes amis et moi avions l’habitude de nous donner rendez-vous, ou le pont des Arts où nous nous retrouvions pour casser la croûte et partager une bonne bouteille de vin, ou encore le quartier de la Défense, où j’ai emmené ma copine Bosie lors de son premier séjour à Paris, en 2007. Ce que je retiens de ces lieux, outre leur intérêt culturel évident, c’est leur rôle de décor dans certains épisodes de ma jeunesse parisienne. S’il m’arrivait aussi, évidemment, de me promener seul en ville, je ne garde pas, de ces promenades, de ces moments solitaires, un souvenir exalté. Tout seul, je passais le plus clair de mon temps à noircir des pages dans ma chambre (plutôt que dans les cafés), et quand je sortais c’était pour rencontrer des gens ou pour aller à la fac. Pendant toutes mes années à Paris, je n’ai jamais visité la tour Eiffel ou la basilique de Montmartre. Quant à l’arc de Triomphe, je l’ai vu de près uniquement parce qu’il y avait une amie – celle de mon récit – qui habitait dans le coin: à chaque fois, en sortant du métro à Argentine, je voyais le monument qui se dressait devant moi comme une image d’Épinal.
Imaginons un Samuel Beckett voyageur du temps qui arrive dans le présent pour passer la journée avec vous. Que feriez-vous pendant cette journée et où iriez-vous ?
En toute franchise, mon premier réflexe serait de décliner respectueusement l’invitation, car la seule perspective d’une rencontre en tête-à-tête avec Beckett me remplit d’angoisse et d’appréhension (ne parlons même pas du fait de devoir passer une journée entière en son auguste compagnie). Je suis plutôt nul en conversation, j’ai tendance à bafouiller, et dire que je n’ai pas la repartie facile est une douce litote ! Je serais paralysé par la peur de sortir une bêtise ou de faire une faute de français devant lui. Et puis j’ai lu que Beckett était lui-même assez réservé de nature et pouvait se montrer distant, limite froid et cassant, avec des inconnus. Mais, cela dit, je suppose que ma curiosité finirait bel et bien par l’emporter sur mes scrupules et que je ne me ferai pas prier pour aller à sa rencontre. Je me réjouirais surtout de pouvoir enfin entendre sa voix en français, car parmi les enregistrements qui ont refait surface au fil des ans, tous sans exception ont été enregistrés (souvent à l’insu de Beckett) par des anglophones.
Qu’est-ce qui vous a fait rédiger cette «Lettre à un inconnu» directement en français ?
Plutôt que le résultat d’une décision prise au moment de l’écriture, je dirais que le choix du français s’est imposé de lui-même puisque cela fait un petit moment que j’écris, plus ou moins exclusivement, en français. Comme je le précise dans la version anglaise de mon texte (précision qui est absente de l’original français, qui n’en a pas besoin), le fait de l’avoir écrit en français est la conséquence logique de mon désir de vivre mon quotidien dans cette langue. Je pense à Vladimir Nabokov en exil à Berlin, dont le refus d’apprendre l’allemand était motivé par la peur de corrompre et perdre sa langue russe, la seule chose de Russie qu’il avait réussi à sauver en fuyant son pays natal. Je l’imagine penché au-dessus de sa table de travail, les volumes de son dictionnaire russe à portée de main, en train de noircir des feuilles de son écriture serrée et régulière. Locuteur esseulé d’une langue qui appartenait à un monde disparu, il écrivait désormais pour un public de quelques milliers d’émigrés russes, dans le meilleur des cas. Si l’on me permet cette comparaison un peu osée et grandiloquente, c’est la langue française qui est mon trésor sauvé de la France. Je ne veux rien tant que rattraper le temps perdu, les années où j’ai délaissé ce trésor qui sommeillait en moi.
Au cours de votre travail de traduction entre la version originale et la version anglaise, avez-vous eu des surprises ou des découvertes ?
Je ne sais pas s’il y a vraiment eu des découvertes ou des trouvailles, mais je me suis rendu compte, une fois de plus, à quel point il m’est impossible de dire la même chose dans les deux langues, pourtant assez similaires, étymologiquement, lexicalement, et parfois même grammaticalement. Cela a donné lieu, et ce malgré moi, à des formulations sensiblement différentes entre les deux versions. En français, j’ai tendance à faire des phrases plus longues et à ne pas lésiner sur les détails, alors qu’en anglais je suis plus discret, plus laconique, je tends vers la simplification, l’épure, c’est d’ailleurs ce que j’ai constaté en traduisant mon texte, différence qui s’explique aussi, bien entendu, par les particularités de chaque langue.
Votre texte parle des moments de suspension qui existent entre les phases d’une vie et entre les identités d’un écrivain. Ces identités, ces phases, sont-elles ancrées dans une langue, une époque et un lieu particuliers, ou bien avez-vous trouvé d’autres moyens par lesquels les aborder ?
Les liens sont toujours aussi étroits entre mes identités d’écrivain et les langues que je pratique au quotidien, pour autant que je puisse en juger par moi-même. Je l’ai déjà dit ailleurs, mais dans ma tête tout tourne autour de la langue, même si je sais que culture et langue sont au fond indissociables. Or, pour moi, il n’y a pas de France sans la langue française. C’est pourquoi je trouve de plus en plus difficile d’écrire sur la France, sur mon vécu français, à moins de le faire dans la langue de ce pays, de ce vécu. Pour prendre un tout autre exemple, j’ai toujours parlé coréen avec ma mère, ce qui fait que je suis foncièrement incapable de lui parler dans une autre langue. Il faut savoir qu’en coréen, il n’y a pas de pronoms personnels, pas de « il » ou de « elle » (la phrase coréenne peut s’en passer). Par la suite, cela me fait toujours un peu bizarre d’utiliser le pronom she pour parler de ma mère avec un locuteur anglophone. Cela sonne faux dans ma tête. J’ai l’impression de décrire quelqu’un d’autre, quelqu’un qui n’est pas ma mère.
Quels sont vos projets en chantier ?
Je suis actuellement en train de réunir de la documentation pour me lancer dans mon prochain projet d’écriture, et dans le même temps je continue de travailler à divers textes que j’envoie à des revues, toutes francophones. Ce n’est pas faute d’avoir essayé du côté des revues et des magazines en anglais, mais la majorité des textes qui ont été publiés ces deux dernières années l’ont été dans des revues québécoises et françaises. Dans le contexte de mes efforts pour vivre en français, cela n’a fait que m’encourager à continuer sur cette voie, malgré la réalité de mon isolement linguistique en Californie.
Avez-vous eu des coups de cœur parmi vos lectures récentes ?
Il y a un auteur japonais, Akira Mizubayashi, qui vit au Japon mais écrit en français. Son premier livre, Une langue venue d’ailleurs, raconte son apprentissage du français, langue à laquelle il voue un amour inconditionnel. J’ai découvert son livre en 2014, à Tokyo, au rayon littérature française de la grande librairie Kinokuniya de Shinjuku. Depuis, je le relis au moins une fois par an, c’est un magnifique et touchant témoignage. Ses livres ont rencontré un certain succès en France et on commence même à le considérer, dans les pays francophones, comme un auteur important. C’est à l’âge de dix-neuf ans qu’il a décidé d’apprendre le français, à la suite de ce qu’il décrit comme un « malaise linguistique » ressenti à l’intérieur de sa langue maternelle. Ce qui fut aussi mon cas, même si j’ai grandi entre deux langues « maternelles ». Mais je me reconnais volontiers dans son amour de la langue française et – en tant qu’Américain de culture coréenne écrivant en français – dans son sentiment d’exil au sein de sa propre culture, dans sa non-appartenance à la société du pays dont il a pourtant la citoyenneté.
Éditrice: Aube Rey Lescure.
Photo par Léonard Cotte.